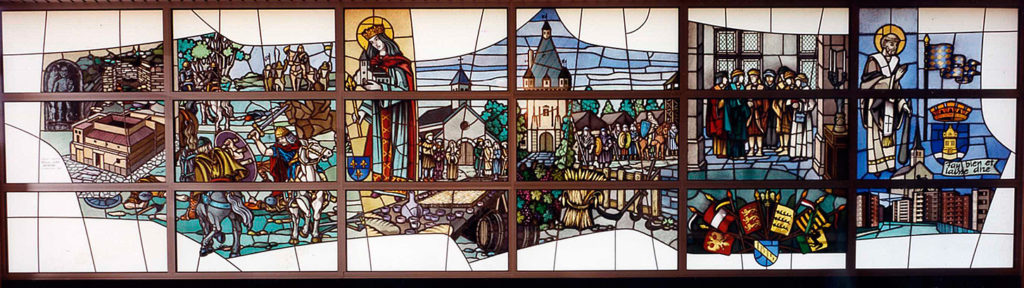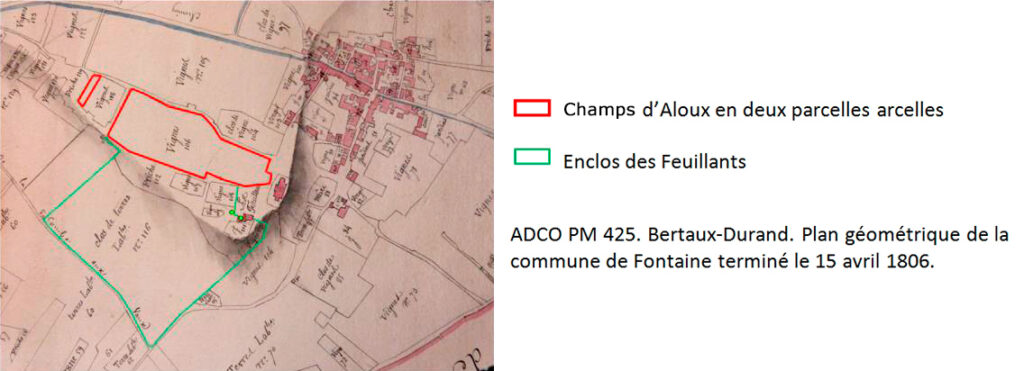Ce cliché d’amateur qui montre une pressée à Fontaine, le 18 octobre 1888, est un tirage sur papier signé Paul Defranc. Paul Defranc, né à Dijon en 1851 et mort à Fontaine en 1902, était un célibataire, qui habitait, avec ses parents, la demeure appelée « la Charmille », 2 rue de la Source. Paul Defranc descendait d’une lignée d’avoués à la cour d’appel de Dijon. Son grand-père, Claude, avait acheté le domaine et à sa mort en 1854, il l’avait transmis à Charles Defranc, le père de Paul. Ce domaine était composé à l’origine de la maison où la famille passait l’été et de quelques parcelles de vigne en plants fins. Le joyau étant le clos séparé de la maison par la rue Collin-Barbier qu’il bordait à l’ouest. L’étendue des vignes avait gagné en superficie au cours des années et Paul Defranc s’en occupait avec un vigneron : Jean Falconnet. Il avait obtenu plusieurs récompenses pour ses vins rouges et blancs lors de concours à Paris dont une médaille d’argent à l’exposition universelle de 1900 dans la catégorie des vins ordinaires.
La photo met en scène cinq hommes en longs tabliers et casquettes, place de Siry, devant la maison du 20 rue des Templiers. À gauche, un homme tourne la roue d’un pressoir horizontal monté sur roues. Il presse les raisins qui sont enfermés dans une cage carrée en bois. Le jus se déverse sur une « maie » qui est un bac situé dans la partie basse du pressoir. Il s’écoule par une « goulotte » dans un demi-muid, le muid étant synonyme de tonneau. Le jus est ensuite transvasé dans une «tine». La tine est un demi-tonneau dont deux douelles plus longues que les autres, placées en opposition, sont percées pour former des anses ou oreilles, dans lesquelles est passé un bâton appelé « tineau ». L’ensemble repose sur les épaules de deux hommes qui avancent l’un derrière l’autre pour transporter le jus jusqu’au fût où il sera transvasé. Juché sur le pressoir, un homme tient un marteau à la main. Deux manches de « grappine » pour égaliser la vendange dépassent de la cage en bois. Près du chasse-roue, à l’angle gauche de la maison, deux « benatons » ou paniers à vendange sont posés sur une brouette. Ils sont accompagnés d’un petit baquet en bois appelé sapine.
Sigrid Pavèse avec la collaboration de Bruno Lautrey, Jean-Christophe Lornet, Jean-Louis Nageotte, Élisabeth Réveillon.
Site : www.lesamisduvieuxfontaine.org (Publication juin 2019)