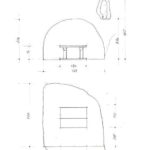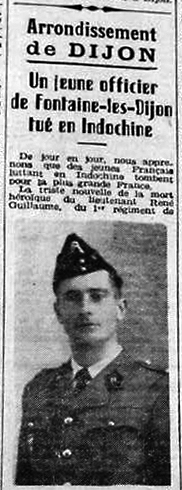Eugène Nicolle juché sur une charrette un jour de vendanges (Entre-deux-guerres), collection particulière.
Le 1er octobre 1850, le maire de Fontaine, Claude Gruet, est amené par les circonstances à prendre un arrêté[1] de police rurale à la veille des vendanges qui, cette année-là, vont débuter dans la commune le 5 ou 6 octobre courant[2]. En effet, chaque année le transport des vendanges est entravé par de multiples obstacles dans le village : fumier, boues, bois et autres matériaux. Les propriétaires ont 4 jours pour les enlever et libérer les rues et places du bourg. Il est aussi défendu de laisser stationner pendant la nuit les voitures, tombereaux et charrues qui doivent être remisés soit sur la place « du » Carrois, soit près de la mare. Les gardes champêtres sont spécialement chargés de l’exécution de cet arrêté et habilités à dresser des procès-verbaux à tous les contrevenants.
Dans les faits, cette décision a été provoquée par un arrêté préfectoral sur la salubrité publique. En effet, avec l’établissement de la Seconde République, le 25 février 1848, le législateur se préoccupe d’hygiène publique et institue le 18 décembre 1848 une commission de prévoyance et d’assistance. Or, de tout temps, la salubrité extérieure, la sûreté des rues et des places, la propreté, la commodité des voies de circulation ont été l’apanage de l’édilité. Pour se conformer aux circulaires préfectorales, le maire a donc prescrit l’enlèvement de tout ce qui pouvait gêner la circulation sur la voie publique. La solution à ce problème consistait surtout à trouver des endroits dans la commune pour contenir ces différents dépôts. Le conseil municipal assigne donc trois emplacements devant servir exclusivement aux dépôts de fumier, bois, pierre et autres objets qui étaient placés jusqu’à présent dans l’intérieur du village. Il s’agit du terrain appelé le Carrois à l’entrée sud du village, d’un lieu situé aux Échannes, derrière le clos où se trouvait l’ancien hôtel des Cotottes et enfin de l’espace entre le 32 rue Jehly-Bachellier et la mare. Quant à l’actuel parking des Cotottes, il est réservé pour servir de creux à fondre la chaux. Le conseil municipal voit aussi dans cette mesure l’opportunité de procurer à la commune un supplément de revenus pour les dépenses qu’elle doit supporter annuellement et pour cela assujettit les habitants qui soumissionneront à une indemnité modeste, réglée à l’amiable et sans frais, pour chaque mètre carré de terrain occupé…
En remettant les stratégies de lutte entre les mains des autorités locales, la loi du 13 avril 1850 sur les logements insalubres, votée par la Seconde République finissante afin d’améliorer le sort des citoyens pauvres, a donc eu, à Fontaine-lès-Dijon, cette singulière conséquence d’aboutir à faciliter les déplacements des véhicules dans la commune au moment des vendanges…
Sigrid Pavèse
[1] Archives municipales de Fontaine-lès-Dijon, D2, Registre de délibérations.
[2] En 1850, le ban de vendange n’a plus de caractère d’obligation.