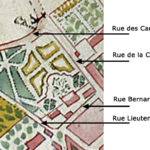À Fontaine, comme ailleurs, les femmes sont transparentes dans les archives communales déjà déficitaires pour ce qui concerne la vigne. Nous ne savons presque rien d’elles. Pourtant elles ont toujours travaillé dans les vignes, car les exploitations étaient surtout familiales et impliquaient toute la famille. C’est elles, n’en doutons pas, qui ont aidé à construire, à Fontaine, l’un des plus grands vignobles du Dijonnais. Juridiquement, socialement, économiquement assimilées à des individus mineurs, les femmes étaient des auxiliaires qui occupaient une place primordiale dans le travail de la vigne mais restaient toujours dans l’ombre de l’homme, en soutien d’un mari, d’un père ou d’un frère[1]. Assignées à une multiplicité de tâches considérées comme subalternes mais indispensables, dans la sphère agricole comme à l’intérieur du foyer, elles étaient corvéables à merci et leur travail était loin d’être le moins pénible. Tout au contraire, il était très éprouvant car les femmes travaillaient souvent courbées.
C’est un fait que le secteur viticole a toujours opéré une différenciation forte des tâches. Les hommes se réservaient celles qu’ils considéraient comme nobles ou plus qualifiées. Ils labouraient et taillaient la vigne mais ce sont les femmes qui ramassaient les sarments, ébourgeonnaient, écrêtaient (rognaient), relevaient, palissaient, coupaient le raisin. Le monde viticole était un monde sexué et les femmes étaient tenues à l’écart de l’élaboration du vin. La cuverie était exclusivement affaire d’homme. Après le phylloxéra, cette différenciation a perduré car la mécanisation a été réservée aux hommes. Pendant la Première Guerre mondiale, les hommes étant mobilisés, les femmes les ont remplacés dans la marche des exploitations mais, avec le retour de la paix, chacun a repris sa place. En 1926,[2] le syndicat des producteurs de fruits de Fontaine-lès-Dijon est ouvert aux femmes non mariées, majeures, et aux veuves majeures mais elles ne peuvent faire partie ni du bureau, ni de la commission de contrôle. En France, quand la féminisation du monde agricole s’est opérée, il n’y avait plus de vigne à Fontaine… et, aujourd’hui, pour s’occuper de la Vigne de Fontaine, on ne voit que des hommes!
Sigrid PAVÈSE
[1] Archives municipales de Fontaine-lès-Dijon, Jeanne Lelièvre, La vie au temps des encendrés.
[2] Article 5 des statuts du syndicat des producteurs de fruits de Fontaine-lès-Dijon adoptés le 9 décembre 1926.